La vérité - Cours de Philosophie
100.27k views2235 WordsCopy TextShare

Coursitout
Retrouvez-moi en live sur Twitch : https://www.twitch.tv/coursitout ! Dans cette vidéo, nous allons ...
Video Transcript:
# Introduction Dans cette vidéo, nous allons continuer notre série de petits cours en philosophie en nous intéressant maintenant à la vérité. # 1. **Pourquoi faut-il connaître la vérité ?
** ## 1. 1 La vérité est une nécessité pratique : la justice et la confiance Dans le film *12 Hommes en colère,* 12 jurés sont convoqués afin de délibérer quant à la culpabilité d'un suspect. Si l'homme s'avère être coupable, celui-ci sera condamné à mort.
Et comme le procès se déroule aux États-Unis, il ne faut pas simplement que les jurés obtiennent la majorité dans leur décision, mais l'unanimité. Ce film est particulièrement intéressant, car il montre l'intérêt de rechercher la vérité dans un contexte juridique ainsi que la notion de doute raisonnable. Et pour que les jurés jugent le suspect coupable, il ne faut pas nécessairement que sa culpabilité soit avérée, mais seulement qu'elle dépasse le "doute raisonnable".
En d'autres termes, ce qui est recherché, ce n'est pas tant la vérité absolue, mais plutôt un jugement suffisamment certain pour qu'il résiste à un doute dans la limite de la raison. On se rend ainsi compte que cette notion de doute raisonnable est assez floue. Car le jugement des jurés, qui sont censés porter un jugement juste, est en réalité bien souvent obscurcie par des opinions personnelles.
Et comme le jugement qui est rendu n'est que la somme de ces décisions individuelles, il semble en fin de compte très subjectif. Un homme condamné par certains jurés ne le serait peut-être pas par d'autres et inversement. Mais si la vérité dans un contexte pratique peut être difficile à obtenir, l'est-elle également dans un contexte plus théorique ?
## 1. 2 Platon : La recherche de la vérité est essentielle pour l'homme Dans le *Ménon*, Platon cherche entre autre à montre que la connaissance ne peut se tirer que de nous-mêmes. Qu'elle ne peut jamais venir de l'extérieur.
Le raisonnement, c’est que : ce que l’homme connaît, il ne le cherche pas parce qu’il le connaît déjà. Et ce qu’il ne connaît pas, il ne le cherche pas non plus, parce qu’il ne saurait pas ce qu’il doit chercher. Donc finalement comment accéder à quelque connaissance que ce soit puisque nous ne pouvons connaître que ce que nous savons déjà et nous ne pouvons pas connaître ce que nous ne savons pas.
On semble tourner en rond. . .
Eh bien pour Platon on ne peut connaître les choses que par le biais de la réminiscence. L'idée de Platon, c'est qu'avant notre naissance, nous avions tous accès à la vérité et à une connaissance parfaite. Mais nous avons oublié en partie ces connaissances lorsque nous sommes passés dans le monde physique.
Enfin pas vraiment oubliée, parce que cette connaissance n'est pas complètement supprimée, elle est seulement voilée et nous pouvons donc la retrouver. Juste pour faire une parenthèse, si cela vous rappelle l'idée de paradis chrétien et de péché originel, c'est normal parce qu'une partie du christianisme peut se comprendre comme une lecture médiévale de Platon. Mais concrètement ce processus d'apprentissage se passe-t-il pour Platon ?
Dans son dialogue, Platon fait appel à un jeune esclave. Par la parole de Socrate, Platon trace un carré dont il marque les transversales et demande au jeune esclave de trouver la marche à suivre pour construire un carré dont la surface serait le double de l’original. Le côté du carré vaut 2.
Il a donc une surface de 4, et il faut construire un carré dont l’aire vaut 8. On demande une méthode à l’esclave, qui répond qu’il faut doubler la longueur des côtés. C'est une erreur, mais cette erreur peut se comprendre comme la première étape de la réminiscence.
Pour lui montrer son erreur, Socrate trace le carré que lui propose l’esclave : il faut se rendre à l’évidence, il est non deux, mais quatre fois plus grand que l’original : l’aire du nouveau carré vaut 4 x 4 = 16, soit le double de 8, la surface recherchée. Le jeune garçon propose alors de construire un carré dont le côté vaut 3. Or ce carré a une aire de 9, ce qui n’est pas non plus le résultat demandé, recherché.
L’esclave est désormais dans l’embarras. Mais selon Socrate, l’esclave a fait beaucoup de chemin : « [. .
. ] à présent le voilà qui considère désormais qu'il est dans l’embarras, et tandis qu’il ne sait pas, au moins ne croit-il pas non plus qu’il sait ». Il est maintenant dans une meilleure situation qu’avant, et son interlocuteur, Ménon en convient.
Socrate trace alors les diagonales et il apparaît que le carré construit sur la diagonale du carré initial est le carré recherché. L’esclave le découvre et affirme maintenant que c’est sur cette ligne que l’on peut construire un carré deux fois plus grand que le premier - ce qu’il ignorait complètement un instant auparavant. Ce que cela illustre, c'est donc que la connaissance de l'esclave est tirée de lui-même.
Certes Socrate l'a aidé dans sa recherche, mais il ne lui a pas imprimé un savoir de l'extérieur, il lui a fait comprendre qu'il avait depuis toujours cette connaissance en lui-même. C'est là tout le but de la maïeutique socratique. # 2.
Mais peut-on réellement accéder à la vérité ? ## 2. 1 Scepticisme, pyrrhonisme et relativisme : la vérité est-elle impossible ?
Cependant, cette vérité est-elle toujours accessible ? Si Platon reconnaît que les sens sont trompeurs, il en arrive à la conclusion que la vérité est pourtant accessible par le biais de la réminiscence. Mais l'est-elle réellement ?
Ne puis-je pas au contraire douter de tout et de ce fait poser le discrédit sur la vérité du monde qui m'entoure ? Comme nous mettent en garde les philosophes sceptiques, il faut faire preuve d'une grande méfiance quant à ce que nous croyons être la vérité. > « Le scepticisme est une faculté et une méthode qui sert a examiner, qui compare et oppose, de toutes les manières possibles, les choses apparentes, ou sensibles, et celles qui s'aperçoivent par l'entendement [.
. . ] » — (Esquisses pyrrhoniennes, Livre 1 [8], Sextus Empiricus) Par exemple, si je regarde une illusion d'optique, mon cerveau me fait croire à quelque chose alors qu'en réalité cela ne correspond pas à la réalité.
Pour Pyrrhon d'Ellis, cela ne signifie pas seulement que les sens sont douteux par rapport à la raison, mais que l'on ne peut se fier ni aux sens, ni à la raison. Nous devons rester sans jugement. Plutôt que de pencher du côté de la vérité ou de l'erreur, nous devons plutôt cesser d'affirmer quoi que ce soit.
Mais, il y a-t-il seulement quelque chose comme LA réalité ? Lorsque je regarde le monde, j’ai une certaine perception qui est propre à mes sens. Je vois la lumière qui s'étend d'une longueur d'onde d'environ de 380 nm à 780 nm et j'entends des sons qui vont de 200 à 20000 Hz.
Mais la perception qu'à une araignée du monde est radicalement différente. Par exemple, la vision de certaines espèces peut s'étendre à 360 degrés. Les abeilles et les papillons sont capables de voir la lumière ultraviolette pour les guider jusqu'aux fleurs à polliniser.
La chauve-souris peut entendre jusqu'à une fréquence de plus de 100,000 Hz. De cette manière, peut-on dire qu'une perception est plus fidèle à la réalité qu'une autre, plus vraie qu'une autre ? ## 2.
2 Descartes : Le doute permet de fonder la vérité Pourtant, même dans le scepticisme, tout n'est peut-être pas perdu pour la vérité. Car pour Descartes, le doute n'est pas une impasse. Plutôt que de s'arrêter au doute absolu, Descartes le considère plutôt comme une étape fondamentale pour fonder la vérité.
Descartes part en effet du constat que nous ne pouvons pas fonder la vérité sur des bases instables. Pour avoir des connaissances certaines, il faut avant tout que les principes soient certains. Or, comme nous l'avons vu avec le scepticisme et le pyrrhonisme, un grand nombre des connaissances que nous prenons pour certaines sont en vérité très douteuse.
Dans sa recherche de fondements certains, Descartes commence donc par tout remettre en question. Et après remis en question tout ce qu'il tenait pour vrai, il en arrive à la fameuse conclusion que : > Je pense donc je suis En d'autres termes. Bien que je puisse douter de tout, je ne peux pas douter du fait que je doute.
Ce qui veut dire que si l'objet de ma pensée peut toujours être remis en question, le fait que je pense est lui certain. Le fondement de toutes connaissances se trouve donc dans le sujet. # 3.
**Mais la recherche de la vérité n'est-elle pas elle-même trompeuse ? ** ## 3. 1 Nietzsche : La vérité est une illusion Cependant, nous nous sommes jusqu'à présent demandé comment accéder à la vérité, mais ne pourrait-on pas s'arrêter un instant et se demander pourquoi cette vérité fait l'objet de tant de recherches ?
En fin de compte, est-ce bien raisonnable de vouloir rechercher la vérité ? Comme le montre Nietzsche, la recherche de la vérité n'est pas entièrement rationnelle. En effet, la vérité est réconfortante pour l'humanité, car elle le protège du monde qui est chaotique et imprévisible.
Mais plutôt que de croire en l'illusion rationnelle que nous propose par exemple Platon, Nietzsche nous invite au contraire à embrasser le chaos et le dynamisme du monde. L'univers est changeant et il n'existe donc pas de vérité immuable. Comme il le dit dans le Gai Savoir.
> Tu vois maintenant une erreur dans cette chose que tu aimas autrefois comme vraie ou comme probable : tu la rejettes loin de toi et tu te figures que ta raison vient de remporter une victoire. Mais peut-être cette erreur, jadis, alors que tu étais un autre - on ne cesse jamais d'être un autre - t'était-elle aussi nécessaire que tes « vérités » d'aujourd'hui ; c'était une sorte de peau qui te cachait, te voilait bien des choses que tu n'avais pas encore le droit de voir- c'est ta nouvelle vie, ce n'est pas ta raison qui a tué cette idée : tu n'as plus besoin d'elle, elle s'effondre sur toi, et sa déraison vient au jour, elle sort en rampant comme un ver. Nietzsche, *Le Gai Savoir.
* De ce fait, la recherche de la vérité ne semble pas si désintéressé. Au contraire, la vérité serait plutôt l'outil privilégié de l'humanité pour se protéger de ce qui lui fait peur, c’est-à-dire, le chaos, l'incertitude, le mensonge. La vérité est un peu comme une coquille qui nous protège, mais qui voile et obscurcie notre vision.
## 3. 2 William James : Le pragmatisme Donc tout en reconnaissant que la recherche de la vérité n'est pas entièrement rationnelle, peut-être ne sommes-nous pas obligés de la rejeter entièrement. Comme le montre William James, il n'est pas nécessaire d'opposer la théorie et la pratique.
James s'intéresse aux conséquences pratiques, comme il le dit lui-même il s'agit seulement de s'intéresser aux "fruits" plutôt qu'aux racines. Mais il s'agit de l'allier à la théorie et pas simplement d'être exclusivement du côté de la pratique ou de la théorie. De ce fait, la vérité pourrait être utilisée de manière pragmatique.
Plutôt que de comprendre la vérité de manière purement abstraite comme une sorte d'idéal de la raison, William James envisage davantage ses conséquences pratiques pour déterminer la vérité. En d'autres termes, cela revient à reconnaître ce que Nietzsche nous disait déjà et envisager la vérité non pas comme une pure abstraction détachée du monde physique, mais comme ce qui nous est utile. # Synthèse Donc pour récapituler ce que nous avons vu dans cette vidéo.
Premièrement, nous avons vu que la recherche de la vérité était à la fois un impératif pratique et théorique. Pratique, car elle à la base de la justice et du système judiciaire par le biais de la confiance, et théorique, car elle ce qui compose le monde intelligible selon Platon. Cependant, cette recherche de la vérité est semée d'embuches.
Le scepticisme nous met en garde contre nos sens et nous invite à douter de nos perceptions. Le pyrrhonisme nous dit qu'il n'y a rien de certains et qu'il faut donc douter de tout. Et le relativisme nous montre que la recherche de la vérité est vaine, car il n'y a pas une seule vérité qui correspondrait à la réalité, mais une infinité de points de vue qui dépendent de l'observateur.
Cependant, c'est cette même démarche sceptique qui permet à Descartes de fonder une base solide à nos connaissances. Enfin, nous avons vu avec Nietzsche et William James que la recherche de la vérité n'était pas si désintéressée que cela et qu'elle pouvait elle-même être remise en question. La vérité ne serait donc pas à comprendre comme une pure abstraction rationnelle, mais plutôt comme un outil pratique que nous pourrions mobiliser de manière pragmatique.
# Conclusion Et sur ce nous en avons terminé avec cette petite présentation de la vérité. J’espère que ça aura pu vous intéresser et que ça vous donnera envie d’en apprendre davantage. Si c’est le cas n’hésitez pas à laisser un like, à vous abonner, voire à devenir un membre de la chaîne, cela m'aiderait énormément et cela vous permettra d'être averti dès que les prochaines vidéos seront publiées.
En attendant, vous pouvez me retrouver sur Instagram, TikTok et Twitter, sur lesquels je publie d'autres petits vidéos qui pourraient vous intéresser. Donc je l'espère à bientôt dans une autre vidéo !
Related Videos

9:50
Le temps - Cours de Philosophie
Coursitout
87,968 views

21:12
La Vérité - Notion au programme du bac de ...
La Boîte à Bac
49,225 views

9:27
La raison - Cours de Philosophie
Coursitout
143,018 views

53:22
QU'EST-CE QUE LA VÉRITÉ ?
Le Précepteur
195,714 views

6:12
Révisions bac philo : La Vérité
Parle Moi de Philo
83,072 views
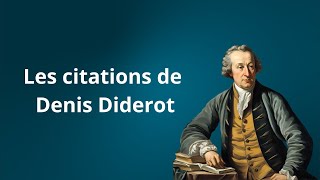
5:11
Les Citations Inspirantes de Denis Diderot...
Hervé&Lucie
2,716 views

24:55
PLATON - La vérité n'est pas de ce monde
Le Précepteur
579,392 views

8:53
La conscience - Cours de Philosophie
Coursitout
219,544 views

10:38
La vérité - Philosophie - Terminale - Les ...
Les Bons Profs
506,973 views

16:35
Les théories des couleurs à travers l'hist...
Treya - Studio de Saint Chat
299 views

19:55
The Surprising Map of Plants
Domain of Science
1,172,235 views

12:09
How To Make Friends
Kurzgesagt – In a Nutshell
6,920,700 views

12:03
À l'Assemblée, ça FLINGUE de partout ! Mic...
Pure Politique
43,136 views

10:30
La religion - Cours de Philosophie
Coursitout
98,120 views

20:39
Why we should go back to writing in runes
RobWords
602,997 views

9:42
La nature - Cours de Philosophie
Coursitout
75,844 views

53:20
Making purple gold
NileRed
19,339,058 views

11:08
La justice - Cours de Philosophie
Coursitout
158,364 views

9:20
La technique - Cours de Philosophie
Coursitout
99,258 views

8:05
Le devoir - Cours de philosophie
Coursitout
38,718 views