Tension inédite entre la France et l'Algérie : la vidéo pour comprendre
1.3M views8226 WordsCopy TextShare

HugoDécrypte - Grands formats
La vidéo pour tout comprendre sur la relation entre la France et l'Algérie.
Pour retrouver mes int...
Video Transcript:
C'est une crise diplomatique, une crise politique extrêmement importante entre la France et l'Algérie. La relation entre la France et l'Algérie a-t-elle atteint un point de non retour ? La France devrait oublier que l'Algérie était autrefois une colonie. Ces dernières années, la tension monte entre la France et l'Algérie. L'Algérie que nous aimons tant et avec laquelle nous partageons tant d'enfants et tant d'histoires entre dans une histoire qui la déshonore. Et une part de ces tensions prend racine dans une histoire commune. Cette histoire, c'est celle de 132 années de colonisation française en Algérie achevée par 8 ans
de guerre. La guerre d'Algérie parfois mal comprise et souvent tabou. La guerre d'Algérie a bouleversé des millions de vies, laissé une empreinte indélbile aux nations françaises et algériennes et conduit à l'indépendance de l'Algérie. Alors aujourd'hui, je vais vous raconter cette période de la colonisation à la guerre d'Algérie. Mais vous entendrez aussi des témoins qui ont vécu cette période dans leur chair avec des perspectives variées. La France nous a abandonné comme des chiens. Il m'a dit "Tu sais mon fils, reviens-nous et les mains propres." Je suis revenue, on va dire les mains convenables. Pour nous, tous
les soirs pendant la guerre était des soirs d'angoisse. On apprenait toujours la disparition d'un ami, d'un parent et cetera. C'est pas simple. Quand le petit il vient me dire "C'est vrai, c'est que tu as fait la guerre, tu as tué des Français." Quand on vit au milieu des bombes, on finit par s'habituer au danger et on continue à vivre comme si de rien n'était. Alors l'histoire tragique de la colonisation et de la guerre hier condamne-t-elle la France et l'Algérie à se déchirer aujourd'hui et demain ? Pour bien comprendre cette relation très spéciale entre la France
et l'Algérie, il faut revenir quelques siècles en arrière. Au Moyen-Âge, le territoire de l'actuelle Algérie est fragmenté entre des peuples et des tribus variées. En 1519, l'Empire ottoman met la main sur ce territoire. Mais dans les faits, la régence d'Alger obtient une forte autonomie et se comporte quasiment en état indépendant. Elle développe des relations économiques et diplomatique avec l'Europe et la France, même si elle reste parfois conflictuelle. En France, le roi Charles règne depuis 1824 et son impopularité est croissante. Alors pour se faire bien voir, il cherche à étendre son influence en Méditerranée face au
Royaume-Uni notamment. L'Algérie représente une opportunité pour sécuriser de nouvelles ressources et de nouveaux marchés pour alimenter l'économie française. Et c'est aussi une position stratégique pour sécuriser les routes maritimes françaises en Méditerranée. Charles 10 ne se fait pas prier. Le 14 juin 1830, à sa demande, les troupes françaises bombardent la ville d'Alger et le 5 juillet, elle s'empare officiellement de la ville, mettant fin à trois siècles de règne de l'Empire ottoman en Algérie. La prise d'Alger marque le début d'une violente période de colonisation qui dure plusieurs décennies. Les troupes du général Bugeot qui dirigent les opérations
dès 1836 ont l'ordre de tout détruire sur leur passage pour soumettre la résistance. C'est la politique de la terre brûlée. J'entrerai dans vos montagnes. Je brûlerai vos villages et vos moissons. Je couperai vos arbres fruitiers. Et alors, ne vous en prenez qu'à vous seul. La violence de la conquête atteint un sommet avec ce que l'on appelle aujourd'hui les enfumades. Les 18 et 19 juin 1845, les troupes françaises affrontent des combattants algériens qui trouvent refuge avec des civils dans les grottes du massif de Dallas, au nord de l'Algérie. Le lieutenant-colonnel français Péicier ordonne de bloquer les
sorties et d'enfumer les grottes. Plus de 700 personnes meurent par asphyxie dont une part importante de femmes et d'enfants. Il est impossible de chiffrer avec précision le nombre de victimes de la conquête entre 1830 et 1871. On estime que l'armée française perd plus de 100000 hommes dont une part importante liée aux maladies. Du côté algérien, 250000 à 400000 personnes seraient mortes pendant cette période selon l'historien Camel Cateb. D'autres estimations font état de 500000 victimes, voire plus. En 1871, la France contrôle la grande majorité du territoire algérien. L'Algérie sera véritablement un cas particulier au sein de
l'empire français. Officiellement, elle est qualifiée par le pouvoir français de territoire annexés et non pas de colonie. Alors que les autres colonies françaises sont administrées par les ministères des colonies ou des affaires étrangères, l'Algérie, elle est rattachée directement au ministère de l'intérieur. Autrement dit, pour les dirigeants français, l'Algérie n'est pas qu'une colonie, mais bel et bien une province française. Cette vision se répand en France comme le révèle une expression popularisée au moment de la guerre d'indépendance par ceux qui veulent garder l'Algérie française. La Méditerranée traverse la France comme la scène traverse Paris. L'Algérie, c'est le
symbole de l'assimilation coloniale et de la mission civilisatrice des politiques aujourd'hui controversé qui visaient à faire adopter la culture française. Mais cet idéal, il est plein de contradictions car il est marqué par des hiérarchies raciales et culturelles. En effet, l'assimilation des Italiens, des Espagnols ou des Maltais qui viennent s'établir en Algérie avec les Français est vu comme possible et souhaitable compte tenu de leur proximité culturelle. Mais les locaux algériens sont jugés fondamentalement différents en raison de leur religion, de leur coutume et de leur organisation sociale. Et la particularité du rapport de la France à l'Algérie
se traduit par un statut unique, ce que les historiens qualifient aujourd'hui de colonie de peuplement. Contrairement aux colonies d'exploitation dont l'objectif principal est l'extraction de ressources. C'est le cas de la Martinique ou de la Guadeloupe par exemple. Une colonie de peuplement implique aussi l'installation en masse et la résidence permanente de colons. Les colons français et européens ont été nombreux, très nombreux à s'installer en Algérie. Au-delà d'un moyen de consolider la domination française dans la région, l'Algérie devient aussi une destination pour des Français et d'autres Européens qui souffrent de pauvreté. Le projet est de créer une
colonie agricole de petits propriétaires car l'Algérie possède de grandes étendues de terre cultivable. Cette logique de peuplement permette à la France d'offrir au colons des terres dont les propriétaires algériens ont été expropriés et d'encourager une installation durable. En Algérie, la population est donc répartie en deux. D'un côté, ce que les Européens à l'époque appellent les musulmans ou les indigènes algériens qui représentent 90 % de la population au début du 20e siècle. Ce sont donc les populations historiques de la région, des toirg, des chaoui ou encore des mozabites et des kabyes. De l'autre côté, les 10
% restants correspondent au colons européens qu'on appellera par la suite les pieds noirs. Il y a une majorité de Français bien sûr, mais il y a aussi des espagnols, des Maltais ou encore des Italiens. Au début, les colons ne sont que quelques dizaines de milliers mais à la veille de la Première Guerre mondiale, il représentent environ 650000 personnes. Ce nombre continue à croître jusqu'à l'indépendance de l'Algérie, moment où les pieds noirs seront plus d'un million. Aux européens non français, la France va promettre des terres, des emplois et même la nationalité ainsi que le droit de
vote et ce contrairement aux Algériens qui ont pourtant toujours vécu dans la région. Du côté paternel, c'est une arrivée espagnole et des branches métropolitaines. Pour les espagnols, c'était une sorte de vue d'Eldorado. Euh il vivait dans la misère dans les endroits où ils étaient. J'ai souvenir d'une enfance heureuse lire le soleil la mer les senteurs. Les inégalités économiques et social sont fortes. Le salaire d'un ouvrier agricole français est 2,5 fois supérieur à celui d'un Algérien. Le taux de scolarisation en 1954 est de 15 % pour les enfants algériens en âge d'aller à l'école contre 100
% pour les Français d'Algérie. Par ailleurs, le développement des villes et des infrastructures est fort, mais il est essentiellement capté et mis au service des Français d'Algérie et d'entreprises françaises. Je suis née à Cherchelle, c'est une petite ville allée à 100 km à l'ouest d'Alger. Mes parents sont d'origine très modeste, même même pauvre. Là, j'ai bien vu la ségrégation dans un quartier arabe. On appelait ça le quartier musulman. On était à peu près neuf familles et moi j'étais scolarisée. La scolarisation n'était pas obligatoire pour les Arabes. Était obligatoire pour les Européens mais pas pour les
Arabes. Et donc je ne connaissais pas d'autres vies ailleurs pour aller dans ce lycée. Je passe par un bouvoir central et là je me je vois un autre monde, des européennes avec des petites Fatma qui portaient les coupfins, les petits Yaoul qui couraient derrière les petits français pour pour cirer les chaussures et ça évidemment ça m'a interpellé, j'étais un peu choquée. C'est un rejet qui était fait à notre rencontre en rencontre par nos petits camarades français qui ne perdit pas une seule occasion de nous montrer leur supériorité. Tous les locaux ne sont d'ailleurs pas log
en Algériens juifs qui représentent 1 à 2 % de la population obtiennent la citoyenneté française en 1870. Les Algériens musulmans, eux, sont français juridiquement, mais ils ne disposent que d'une citoyenneté diminuée. Ils doivent accomplir leur service militaire à partir de 1912 sans pour autant avoir le droit de vote pour les élections nationales. Ils ont aussi accès à certains emplois publics, mais pas à tous. Ils peuvent aussi s'engager dans l'armée française mais ne peuvent pas dépasser certains grades. Il faudra finalement attendre 1958 pour qu'ils acquièrent une citoyenneté française pleine et entière avec les mêmes droits civiques
et politiques que les autres citoyens français. Et entre les Français d'Algérie et les Algériens, le déséquilibre est conséquent. En 1947, par exemple, est créé une assemblée locale algérienne constituée de 60 élus français et 60 élus algériens. une représentation inégale quand on sait que les Algériens sont beaucoup plus nombreux que les Français d'Algérie. Et de toute façon, cette assemblée locale, elle n'a qu'un rôle minime et elle reste subordonnée à l'administration française. D'autant plus que les élections d'avril 1948 sont truquées par les autorités françaises qui favorisent les Algériens proançais alors que les nationalistes algériens cumulaient les succès
électoraux au municipal l'année précédente. En somme, les Algériens sont cantonnés au rôle d'Éternel II. Au fil des années, des voix s'élèvent contre l'action de la France en Algérie. En 1881, l'écrivain français Guuy Mopassan, envoyé spécial sur place pour le journal logolois, publie plusieurs reportages extrêmement critiques. Rien ne peut donner une idée de l'intolérable situation que nous faisons aux Arabes. Le principe de la colonisation française consiste à les faire crever de faim. C'est dans ce contexte qu'un mouvement national algérien né dans les années 1920-130 prend de l'ampleur en promouvant l'idée d'une indépendance de l'Algérie. Un courant
d'indépendantistes révolutionnaires se développe et revendique une rupture forte avec la France par l'emploi de la violence si nécessaire. L'indépendance quoi qu'il en coûte. Certes, des réformistes, mouvement de bourgeois et d'intellectuels locaux, croient initialement à la possibilité de l'assimilation avec des droits égaux pour les Algériens au sein de la République française. Mais l'année 1945 mène à une forme de radicalisation. Le 8 mai, l'Allemagne capitule, la Seconde Guerre mondiale s'achève. Des défilés sont organisés pour célébrer la liberté retrouvée. Défilé auquels les Algériens prennent part pour revendiquer aussi une évolution de leur statut et de celui de l'Algérie.
Dans les cortèges, des emblèmes nationalistes et indépendantistes algériens sont affichés et les policiers français ont pour consigne de les confisquer. Bitzal, 26 ans, est abattu parce qu'il brandissait un drapeau algérien. C'est par là que débute la violence et l'insurrection à cétif. En réponse, les manifestants algériens s'en prennent notamment au bâtiment public. La répression française, très brutale, entraîne la mort de milliers d'Algériens. Le bilan est difficile à établir. Une commission d'enquête évoque 8000 à 10000 Algériens tués. Les historiens par le eux de 15 à 20000. En face, une centaine d'Européens sont tués dont une part a
subi des mutilations physiques violentes. Suite à la répression de 1945. Et comme les réformes attendues n'arrivent pas, la vision des indépendantistes l'emporte. Cette idée donc selon laquelle la lutte armée est la seule façon de libérer l'Algérie puisque aux yeux des Algériens, lorsqu'ils manifestent pacifiquement, il court le risque d'être réprimé voire tué. Dans ce contexte où le moindre incident peut dégénérer, émerge une organisation qui marquera à jamais l'histoire de l'Algérie, le front de libération nationale. À l'automne 1954, le FLN lance une série d'attentats. C'est le début de la guerre d'Algérie. Dans la nuit du 1er novembre
1954, le FLN revendique 70 attentats à travers l'Algérie visant principalement des installations militaire, des postes de police et des propriétés de colons français. Le bilan humain est d'une dizaine de morts mais la portée est forte. C'est la première action publique qui révèle le FLN ainsi que son bras armé, l'ALN, l'armée de libération nationale en tant que meneur de l'indépendance algérienne. Cette série d'attaques qualifiée de Toussin Rouge accentue encore l'escalade qui devient incontrôlable. que j'étais lycéen et j'avais décidé de mettre des bombes dans des lampadaires. Il y en avait un juste à l'arrêt de bus de
mon lycée à un un tram prêt et je sautais sur une bombe. La répression est ferme. Des renforts de police sont envoyés et la position du gouvernement est claire. François Mitteran, à l'époque ministre de l'intérieur déclare "La seule négociation c'est la guerre. L'Algérie, c'est la France et la France ne reconnaîtra pas chez elle d'autres autorités que la sienne. Et là quand vous voyez le nombre de camions et militaires qui passaient, les militaires qui étaient là qui vous fouillaient, euh quand vous voyez les forêts brûlé déjà, là on se rend vite compte que les choses ont
changé, hein. Malgré tout, le gouvernement français veut croire à la possibilité d'un compromis. En 1955, il nomme Jacques Soustell gouverneur général de l'Algérie pour mener une politique d'intégration des Algériens. Mais à peine quelques mois plus tard, un rebondissement brutal change la donne. Le FLN a en effet l'indépendance pour objectif. Il menace et violente les Algériens qui ne le soutiennent pas. Et le 20 août 1955, il lance un soulèvement d'Algériens dans le nord du Constantinois qui s'attaque aux Européens, tuant une centaine de personnes. Des Français d'Algérie organisent des représailles. L'armée française intervient et comme en 1945,
le bilan exact est discuté mais des milliers d'Algériens sont tués. Cet événement est un point de non retour. D'une part, les Européens se dressent en bloc contre l'action du FLN, synonyme de massacre à leurs yeux et attendent une répression sévère. D'autre part, les Algériens, indignés par l'ampleur de la répression dont ils font l'objet, se radicalisent et se rangent toujours plus derrière le FLN, y compris ce qui était les plus modérés. Face à ce constat, le gouverneur général Soustel abandonne la piste réformiste et priorise le rétablissement de l'ordre et l'action militaire contre le FLN. Il devient
l'idole des Français d'Algérie. Quelques mois plus tard, l'instabilité politique mène à de nouvelles élections législatives en métropole. Le gouvernement qui vient d'entrer tient à nouveau à explorer le scénario des réformes et du compromis en Algérie. Le nouveau président du conseil des ministres, qui est donc l'équivalent de notre premier ministre aujourd'hui, se rend sur place pour lancer ce chantier et installer à son poste le remplaçant de Jacques Soustel. Mais il est accueilli par des jets d'œufs et de tomates de la part des pieds noirs. Alors le gouvernement fait marche arrière et décide de tenir compte de
l'angoisse des Français d'Algérie qui ont peur de voir la France se retirer de l'Algérie. En mars, l'Assemblée nationale vote massivement les pouvoirs spéciaux au gouvernement qui obtient donc tout pouvoir pour rétablir l'ordre. Le recours aux militaires devient massif. Outre les appelés qui font donc leur service militaire, on rappelle des jeunes hommes qu'il avait déjà fait et au total, les jeunes français peuvent passer jusqu'à 36 mois en Algérie pour prêter ma main forte. Et pour vous donner un ordre de grandeur, les effectifs militaires français qui étaient d'environ 50000 hommes en 1954 passent à 350000 hommes à
la fin 1956. Nous étions encadrés par un sergent chef, un ancien qui avait fait donc 39 45 et l'indogine et qui était chargé de nous apprendre le maniment des armes, comment on pouvait se débrouiller avec les cartes, comment venit du tir. On fait des exercices d'embuscade. La plupart du temps, nous étions pas en race campagne mais tout juste sous la tente, c'està-dire c'était des tentes américaines de la guerre 3945 et nous étions là-dessous. Les objectifs affichés sont le quadrillage du pays, le ratisage des villages et le regroupement des populations en vue d'affaiblir les combattants algériens
qui dépendent du soutien des villageois pour survivre. Pourtant en métropole, le discours officiel et les médias parlent pudiquement des événements d'Algérie. La guerre d'Algérie, on en parlait pas beaucoup en métropole parce qu'il y avait une espèce de censure. Donc à la télévision, on voyait des reportages, très peu, disons pas de combat, tout allait à peu près bien et on parlait pas du tout d'opération c'était calme plat, il y avait rien à dire mais on ne savait pas du tout où on allait. Et pourtant, la réalité est violente sur le terrain. La guerre est asymétrique au
sens où elle oppose une armée régulière d'un côté à des combattant avec bien moins de moyens de l'autre côté recourant aux attentats étonnants grâce au soutien de la population. Concrètement, l'armée française recourt à la torture, à des fins de renseignement mais aussi de terreur. Les violences ont pour logique de dissuader les Algériens de s'engager au FLN. Parmi les affaires médiatisées à l'époque, celle de Jamila Basacha. membre du FLN, elle fournira des aveux après avoir subi entre autres des viols et la torture à l'électricité. En face, les violences du FLN ont une autre logique, punir celles
et ceux qui s'y opposent ou bien tout simplement qui ne le soutiennent pas activement. Fin 1956, on recense 3000 attentats par mois. L'objectif de l'armée française est clair, garder l'Algérie française. Et pour cela, au-delà de l'usage de la force, l'armée française accentue les initiatives du soutien médical et éducatif à la population dans l'espoir qu'elle n'adhère pas aux idées du FLN. D'ailleurs, de façon croissante durant la guerre, des Algériens rejoignent les rangs de la France au sein de groupes paramilitaires. Ils le font pour raisons multiples. D'abord, le revenu proposé, ensuite par opposition au FLN et à
l'ALN. Et enfin marginalement par attachement à la France. On appelle ces soldats les harquis et on estime qu'ils étaient jusqu'à 57000 en 1961. Je me suis engagé le 7 juillet 1957. C'était pas difficile les militaires passaient avec un camion euh ils invitent euh les Algériens à s'engager comme Arquis. C'était en quelque sorte sauf qu'il peut ou rejoindre le Maki ou s'engager dans l'armée française. Les Arquis on était très très mal vu, hein. Les gens ils nous aimaient pas du tout, ils nous montrai du doigt hein. En 1957, 3 ans après le début de la guerre
survient un tournant majeur. C'est la bataille d'Alger. D'un côté, l'armée de libération nationale, le bras armé du FLN, déploie une intense campagne de guerria urbaine. Les attentat à la bombe dans les lieux publics ou encore les assassinats se multiplient. Ils ciblent l'armée française, la police et les colons européens. Mais pas seulement. Les Algériens qui ne se soumettent pas à l'autorité du FLN sont aussi pris pour cible. Je rejoins l'armée de libération nationale avec un uniforme de l'arbitre de libération nationale, le fusil, le la casquette du Makisar et cetera et cetera. Donc ça a été ma
trajectoire jusqu'à l'indépendance. On mangeait presque pas, on avait rien à manger, très peu. On mangeait un un pain, un pain, une boîte de sardine par jour. Je dormais à la belle étoile. Vous voyez des gens des gens au loin, vous tirez mais vous savez pas qui vous avez touché. Ça n'existe pas. quelquefois on voit des copains qui sont morts, des amis qui sont morts qui a qui a sauté sur une mine, il n'a plus de jambes et cetera et on l'intègre, il y a rien à faire, c'est comme ça. Vous êtes en train comme on
dit, de ratisser, vous êtes plusieurs milliers ou s au milieu, il y a un moment donné, il y a un contact où ils se rendent ou ils se battent. Généralement, ils se battaient. Apprendre d'être en de monter une embuscade généralement c'est se poster la nuit à un endroit qui est supposé être le passage de ce qu'on appelait les adversaires ou les ennemis et d'attendre s'ils passent et de leur tendre une embuscade à savoir ben de les éliminer ou les arrêter ou du moins les éliminer. Des fois on se RT à des à des combattants du
FLN et bon ça tirait dans tous les sens. Parfois on revenait avec des morts. Euh parfois non. De l'autre côté, c'était pareil, hein. Bon, des fois, il y a des embuscades. Moi, je me rappelle là où j'étais un jour, on a une ambiscade. Il y avait quand même 15 morts, 15 morts archis qui ont été tués, hein. Le gouvernement accorde des pouvoirs étendus à l'armée afin de riposter et d'organiser une répression brutale contre les indépendantistes du FLN. Les fouilles, les arrestations et les perquisitions se multiplient. La torture est généralisée et son emploi est théorisé. C'est
vrai que pour nous tous les soirs pendant la guerre étaiit des soirs d'angoisse. On apprenait toujours la disparition d'un ami, de d'un parent et cetera. Et un soir, on est venu arrêter mon père. On savait pas si si on allait le revoir, s'il était mort ou vivant. Quand on est allé voir mon père pour la première fois, c'est indescriptible parce que on rencontre un être terrorisé qui ne vous reconnaît pas, les cheveux longs, la barbe blanche et bon le premier jour a été pour nous euh une une horreur. L'armée française finit par remporter la bataille
d'Alger dans la mesure où elle réduit à néant le FLN dans la ville. Mais l'on peut tout de même noter qu'elle perd sur le plan politique vis-à-vis des Algériens qui en sont massivement victimes. Tandis qu'en métropole, la torture fait scandale, la guerre est de plus en plus dénoncée et le FLN, de son côté se développe en dehors de l'Algérie, en particulier au Maroc et en Tunisie où des camps d'entraînement sont installés. En Algérie, les autorités françaises définissent des zones interdites, essentiellement dans les campagnes, afin de priver le FLN de toute base logistique. Entre 2 et
3 millions d'Algériens sont alors déplacés de force, laissés pour compte ou relogés dans des camps de regroupement sous surveillance militaire. Cette stratégie entraîne de très graves pénuries alimentaires, mais aussi une dégradation des conditions sanitaires, une hausse de la mortalité infantile et plus largement un renforcement du soutien de la population algérienne au FLN en opposition donc à la France. les villageois et villageoiseux, enfants, vieillards et ainsi de suite, ceux qui restaient qui étaient ramenés dans un regroupement à un camp qui était donc entouré de barbelet avec des postes de sécurité avec même des chiens bergers allemands
qui gardaient tout ça et il vivait là-dedans regroupés à plusieurs milliers ou plusieurs centaines, ça dépendait. Il y a beaucoup de personnes qui ont vécu qui ont toute leur jeunesse dans dans ce camp. Vous savez que quand les militaires passaient donc pour mettre les les personnes dans les camps de regroupement, il brûlait absolument toutes les vivres, toutes les vivres, les les l'huile qui était entassée, les la semoule, les rien les et dans les camps de regroupement, les gens étaient complètement dénudés. Dans ce contexte, la situation s'en lise. D'une part, le FLN rejette toute négociation sans
reconnaissance préalable de l'indépendance de l'Algérie. En 1958, les indépendantistes en exil créent le gouvernement provisoire de la République algérienne depuis le Ker en Égypte. Ils vont donc s'inspirer du GPRF qui avait été créé par les résistants français avec de Gaulle en 1944. Ferat Abbas rallié au FLN prend la direction de ce gouvernement provisoire. En face, les Français d'Algérie soutiennent la guerre jusqu'au bout. Ils refusent de quitter l'Algérie. Dans cette période, la France est mise en difficulté à l'Organisation des Nations- Unies puisqu'elle n'est pas soutenue par ses alliés comme les États-Unis ou encore la Grande-Bretagne qui
plaident pour une résolution rapide du conflit. Côté français, on peut noter que les gouvernements ne veulent pas renoncer à l'empire colonial. qui fait de la France une grande puissance selon eux et ce surtout que ils ont déjà perdu l'Indochine à la suite d'une guerre que l'armée française n'a pas digéré. D'une certaine façon, certains estiment que l'armée française prend sa revanche en Algérie. En février 1958, l'aviation française bombarde le village tunisien de Saket Sid Youssef où des membres du FLN étaient installés. Le bilan est lourd, 69 personnes tuées dont 21 enfants et provoquent un scandale jusqu'en
métropole. Par conséquent, le président du conseil des ministres est contraint à la démission. C'est encore un exemple de l'instabilité politique de la 4e République instaurée en 1946 qui voit de nombreux gouvernements se succéder et se heurter à la situation de la crise en Algérie sans parvenir à trouver de solutions. Le 13 mai 1958, un nouveau président du conseil est nommé et il est favorable à la négociation et au dialogue avec les indépendantistes. En réaction à l'annonce de sa nomination le jour même, ce 13 mai 1958, la situation dégénère à Alger. Une manifestation massive de Français
d'Algérie hostile à la négociation avec les indépendantistes algériens se termine par l'assaut du bâtiment du gouvernement général avec la complicité de l'armée. Un comité de salut public est formé. Les généraux Massus et Salent la tête. Ils exigent un changement politique pour garder l'Algérie française. Ils sont rejoints par des gaulistes convaincus que la situation exige un homme providentiel. Celui qui est perçu comme le héros de la libération à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, le général de Gaul. Alors qu'il s'était retiré de la vie politique, le 15 mai 1958, Charles de Gaulle se déclare prêt à
assumer les pouvoirs de la République. Sa position sur l'Algérie est plutôt vague, mais il est populaire et il suscite l'espoir des Français d'Algérie, de l'armée et de la population en métropole. De Gaul acceptent alors de revenir au pouvoir à condition qu'une nouvelle constitution soit rédigée pour établir la 5e République. Une 5e République qui renforcerait le rôle du président. Il souhaite alors palier l'instabilité de la 4e République qui empêcherait selon lui de régler la situation en Algérie. De Gaulle obtient vite le pouvoir de déployer sa vision. Le 1er juin 1958, il devient le dernier président du
conseil de la 4e République. Le lendemain, l'Assemblée nationale lui accorde les pleins pouvoirs et le surlendemain, il obtient le droit de réviser la Constitution. Cette 5e République ne fait pas l'unanimité. D'abord parce qu'elle est instaurée suite à un référendum mais sans débat parlementaire approfondi et puis pour son fonctionnement qui présente un risque d'autoritarisme aux yeux d'une partie de la classe politique. Quoi qu'il en soit, dès le 4 juin 1958, de Gaul passe à l'action et se rend à Alger pour tenter de calmer la révolte. Je vous ai compris. Cette formule devenue culte est tirée d'un
discours qu'il prononce ce jour-là face à une foule d'au moins 100000 personnes. Ce discours, on le qualifie souvent d'ambigu puisque pour les partisans de l'Algérie française, ce serait un engagement à maintenir la présence française tandis que ceux qui prôent l'indépendance l'interprètent comme une reconnaissance de leur revendication. Mais en réalité, l'intention de De Gaul est très claire. Dans son discours, il annonce une réforme majeure. Alors que le système électoral colonial séparait les électeurs en deux collèges distincts avec les Européens d'un côté, les Algériens musulmans de l'autre, il souhaite désormais un collège électoral unique appliquant le principe
un homme une voix et ce pour toute l'Algérie. De Gaulle applique ici le principe de la réforme coloniale réformé pour tenter de sauver la colonie mais en ouvrant la porte à un vote égalitaire. En réalité, il précipite la fin de l'Algérie française avec plus de 8 millions d'Algériens musulmans contre 1 million d'Européens. Tout scrutin donnerait désormais la majorité aux Algériens dont la plupart rejette la présence coloniale. Pour beaucoup de personnes, c'était un soulagement. Je crois que aussi bien d'un côté que de l'autre, les gens ont cru vraiment cru que toute cette barbarie allait s'arrêter. Le
FLN n'était plus puissant par rapport à ce qu'il avait été à une certaine époque et arrivé de Gaul avec des paroles qui avaient l'air de dire bon on va changer certaines choses, on va mettre ça à plat. Avec le recul, je me dis c'était une belle utopie. Dans un premier temps, De Gaul tent de négocier avec les indépendantistes. Quelques mois après son retour au pouvoir, il appelle à l'apaisement et propose au FLN ce qui est appelé la paix des braves. Que vienne la paix des braves. Pour dire les choses simplement, il appelle les combattants indépendantistes
à déposer les armes tout en reconnaissant le courage dont ils ont fait preuve. Le FLN rejette l'offre puisque avant toute forme de cesser le feu, il souhaite une garantie, la reconnaissance du droit à l'indépendance. En 1959, face à l'impasse de la situation, c'est historique. Le général de Gaulle reconnaît pour la première fois le droit des Algériens à l'autodétermination et donc à décider de leur destin national. Je considère comme nécessaire que ce recours à l'autodétermination soit proclamé aujourd'hui. Les réactions sont contrastées. Le FLN, par exemple, accueille la proposition avec scepticisme et reste méfiant face à ce
revirement. Les partisans de l'Algérie française, eux, s'inquiètent et s'y opposent. Ils craignent l'indépendance qui semble se rapprocher. Enfin, en France métropolitaine, beaucoup y voi une avancée positive vers la résolution du conflit. Et donc aussi pour beaucoup d'entre eux la fin de l'envoi des jeunes en service militaire, leur fils, leurs frères, leurs cousins ou leurs voisins. Mais en janvier 1960, pour s'opposer à la potentielle indépendance à venir de l'Algérie, des Français d'Algérie s'insurgent et érigent des barricades dans le centre d'Alger. Ils appellent à la désobéissance civile et à la résistance contre la politique du gouvernement. C'est
la semaine des barricades. Face à cela, De Gaul réaffirme sa position et ordonne de rétablir l'ordre sur place. Des confrontations armé éclate entre les insurgés et les forces de l'ordre. Le bilan est lourd, 20 personnes sont tuées, dont gendarmes et plus de 200 personnes sont blessées. L'un des meneurs du mouvement, Pierre Lagillarde, député et ancien parachutiste, est arrêté et emprisonné à Paris. C'est une rupture majeure, une fracture en quelque sorte. des partisans de l'Algérie française deviennent des ennemis du gouvernement en métropole. Dans les mois qui suivent, de Gaul entame des négociations avec le gouvernement provisoire
de la République algérienne, le GPRA et il évoque pour la première fois l'idée d'une Algérie algérienne. C'est un pas symbolique de plus vers la possibilité de l'indépendance. En janvier 1961, De Gaul soumet au référendum sa politique sur l'autodétermination de l'Algérie auprès des électeurs français de Métropole et d'Algérie. Comme le craignait les partisans de l'Algérie française, l'OIi l'emporte massivement avec 75 % des suffrages. L'indépendance de l'Algérie semble plus proche que jamais. Mais alors que le référendum devait ouvrir la voie vers l'indépendance, une ombre se profile dans les semaines qui suivent. L'organisation de l'armée secrète, l'oas. C'est
une organisation clandestine et terroriste déterminée à lutter contre l'indépendance de l'Algérie par tous les moyens. Elle est dirigée par des figures militaire et composé de soldats français, de français d'Algérie civile ou encore de Arquis. Pour nous, c'était les ultras d'Alger. On les appelait les ultras d'Alger des fachaud, pas plus ni moins que des fachaud. Ça ne remettait pas en cause mais il y avait beaucoup de il y avait beaucoup de dégâts. Les pieds noirs de l' se livrait à des des ratonnades terribles hein terribles. Il tuaient bon pourtant comme ça tous les Arabes qui rencontré
dans le rue. L'oas commet de nombreux attentats en France et en Algérie contre des personnalités favorables à l'indépendance et ses forces d'empêcher tout accord avec le FLN. On estime que l'oas fait entre 1600 et 2200 morts, entre 1961 et 1962. L'escalade se poursuit jusqu'en avril 1961 lorsqu'un groupe de généraux français en Algérie opposé à l'indépendance tente un coup d'état contre Charles de Gaulle. C'est le PCH des généraux. J'ai décidé de mettre en œuvre l'article 16 de notre Constitution. En réaction, De Gaul déclenche l'article 16 de la Constitution qui lui accorde les pouvoirs exceptionnels. Assez vite,
la tentative du coup d'état s'écroule en grande partie parce que de Gaulle fait appel à la loyauté de la population et du contingent de jeunes français qui sont en service militaire. Française, Français, aidez-moi. Dans les mois qui suivent, l'escalade de violence se poursuit en Algérie mais aussi en métropole. À partir de l'été, plusieurs attentats sont commis par le FLN contre des policiers à Paris et en banlieu. Alors, la répression policière contre le FLN, certes, mais contre les Algériens plus largement s'accentue jusqu'à ce qu'un sommet soit atteint le 17 octobre 1961. Ce soir-là, le FLN appelle
les Algériens et les Algériennes de la région parisienne à sortir dans les rues et à former des cortèges. L'objectif, boycotter le couvre-feu discriminatoire imposé uniquement aux Algériens en région parisienne par Maurice Papon, le préfet de police de l'époque qui officiellement veut limiter les attentats du FLN. Face aux manifestations, la répression policière est d'une rare violence. Les manifestants sont encerclés, chargés, battus et dans certains cas tués. À ce jour, on ne connaît pas le bilan exact du 17 octobre, mais les estimations font état de plusieurs dizaines de morts pour cette nuit. Et les historiens concluent que
bien plus de 120 Algériens ont été tués par la police parisienne entre septembre et octobre 1961. En Algérie non plus, les violences ne cessent pas. En 1962 a lieu la seconde bataille d'Alger. L'OAS y intensifie ses opérations et commet des attentats à la bombe dans des lieux publics pour semer la terreur et déstabiliser le processus d'indépendance de l'Algérie. Contre la violence, le pouvoir français cherche à démanteler l'oas. Ses membres et responsables sont traqués, un certain nombre sont arrêtés voire même torturés comme le soulligne l'historien Pierre Vidal Naké qui s'était aussi engagé contre la torture des
Algériens. Sur le plan diplomatique, plusieurs rencontres de négociations ont lieu en 1960 et 1961, mais de nombreuses questions restent en suspend jusqu'au 18 mars 1962 lorsque les accords desviant sont signés. La conclusion du cesser le feu en Algérie. Ces accords prévoient un cesser le feu et l'organisation d'un autre référendum dans les 6 mois qui vise à statuer définitivement sur l'indépendance algérienne. L'accord prévoit aussi une coopération entre les deux pays. La France s'engage par exemple à fournir un soutien financier durant les 3 années suivantes et des garanties sont prévues pour les Français voulant rester en Algérie.
En métropole, le sentiment qui domine, c'est que la guerre est finie et qu'enfin les jeunes ne seront plus envoyés en Algérie. En France, les accords déviants sont donc largement approuvés par la population. Seulement en Algérie, les violences se poursuivent. Tant que le référendum confirmant l'indépendance n'a pas eu lieu, l'OAS multiplie les actions afin d'empêcher qu'il ait lieu et donc que l'indépendance devienne officielle. Le 23 mars 1962 à Babelwed, quartier européen d'Alger devenu un bastion de l'oas, de violents affrontements éclatent l'oas et l'armée française. Il y a environ 15 soldats français tués et 77 blessés tandis
que du côté de l'oasombr environ 20 tués et 60 blessés. Et finalement, comme c'était prévu, le choix de l'indépendance est soumis à la population algérienne par référendum le 1er juillet 1962. Une écrasante majorité d'Algériens, plus de 99 % vote en faveur de l'indépendance. Le 3 juillet 1962, Charles de Gaul reconnaît donc l'indépendance de l'Algérie. L'Algérie proclame officiellement son indépendance le 5 juillet 1962. Le 5 juillet étant une date symbolique puisqu'il marque le 132e anniversaire du début de la colonisation française en 1830. Après 8 années de guerre, le bilan humain est considérable. Les chiffres officiels français
dénombrent 25000 soldats français et 140000 combattants du FLN qui sont morts avec par ailleurs 60000 victimes civiles. Les chiffres officiels algériens évoquent quant à eux 1 million à 1 million et demi de morts civiles. Enfin, les historiens évaluent le nombre de victimes civiles à environ 400000. C'était la liè un petit peu l'alliè générale. Je suis rentré en en Algérie, j'ai été démobilisé puis j'ai repris mes études. Au lendemain de l'indépendance, j'étais j'étais un petit peu comme tout le monde, nationaliste. L'Algérie, c'est les meilleurs. Les Algériens c'est c'est les meilleurs. arrive l'échéance près des 27 mois
et on me dit ben voilà, tu repars pour la métropole euh tel jour tuembarques sur le Keran. Je me souviens encore. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Ben on rend son pactage, c'està-dire tout son matériel, son armement. Peut-être une amertume, peut-être aussi une tristesse de quitter les gars. Quand vous passez des mois et des mois avec des gars, il y a des liens forts qui se créent. Donc ensuite ben le train et à côté de moi, il y avait un gars qui avait fait un régiment d'infanterie coloniale et il s'appelait Jean-Claude et à un moment il
me dit "Tu sais Jean-Pierre va te poser une question, on se bat vraiment en Algérie ?" Le copain d'à côté m'a dit "Il est vraiment con, je le balance par la fenêtre." Mais j'ai dit "Non, entre la censure, ils doivent pas savoir ce qui se passe et c'est tout." Ça montre bien que les gens n'étaient pas au courant. En fait, il y avait que les familles qui étaient concernées. La guerre est finie certes, mais l'après-guerre reste marqué par la violence. Le 5 juillet 1962, 2 jours après la reconnaissance de l'indépendance algérienne et quelques heures avant
qu'elle ne soit proclamée, se déroule ce qui est appelé le massacre d'Oran. Selon l'historien Jean Monnery, environ 300 français d'Algérie sont tués par des membres de l'armée de libération nationale et des civils algériens. La plupart des Français d'Algérie quittent le territoire précipitamment pour beaucoup. Certaines estimations font état de 900000 départs pour des raisons multiples, craintte de représaille, mais aussi refus par principe de vivre dans une Algérie indépendante. Mais parmi eux, certains vont aussi rester considérant que c'est là chez eux et nulle part ailleurs, car de nombreux Français d'Algérie n'ont plus de lien avec la métropole
depuis des générations. C'était la folie, les routes vers l'aéroport, les gens laissaient les voitures pour trouver un avion vers le port. Euh les gens faisaient la queue pour essayer de de de d'avoir des places pour les bateaux pour partir. Euh c'était des images horribles. Mon père tous les matins en partant au travail, vous voyez des algériens qui lui faisaient le signe. Alors toujours pareil, c'était pas tous les Algériens. Une fois l'indépendance prononcée, l'OAS décide de s'en prendre à de Gaulle. Le 22 août 1962, au Petit Clamar, un attentat va viser le président pour lui faire
payer, selon eux, l'abandon de l'Algérie française. Un commando de 12 hommes équipés d'armes automatiques et d'explosifs tendant une embuscade au convoi présidentiel. Il tire 187 balles sur la Citroën DS présidentielle et malgré les pneus crevés et des impacts sur la carrosserie, le chauffeur parvient à maintenir le véhicule en mouvement permettant à De Gaulle et à son épouse Yvon de sortir miraculeusement indemme de l'attaque. En cette période qui suit l'indépendance, la défense de l'Algérie française est désormais cantonnée à l'extrême droite de l'échiquier politique alors qu'en 1954, elle faisait largement consensus. Suite à l'indépendance, les Archis eux
se retrouvent dans une situation très précaire. En effet, ils sont abandonnés à leur sort par la France qui ne les accueille pas ou que peu. Certains parviennent à fuir l'Algérie grâce à des soldats français qui désobéissent aux ordres mais la majorité reste en Algérie. Le FLN puis l'armée nationale populaire formée après l'indépendance et poursuivent en représaille. Certains sont arrêtés, torturés ou tués. D'autres retrouvent leur village où ils survivent au prix du silence sur leur passé. La France nous a désarmé et abandonné à notre triste sort. Ils nous ont dit maintenant vous allez rentrer chez vous
et il vous arrivera rien du tout. Sauf qu'on éétait pas tranquille. On irait dans les rues, les arquis, leur famille, les soldats du FLN, la population, ils étaient soif de vengeance. Mon costume de harquy improvisé était devenu ma croix. Je sentais la mort. J'ai dit qu'est-ce que je vais faire ? Toute la population avait été avertie dans mon arrestation. Des pieds nus. Je me souviens toujours. Toute la population venait me cracher sur la viure, me tabasser, me jeter des cailloux. C'était une horreur. Mais ils m'ont amené dans la la salle de torture. M'ont déshabillé. Ils
m'ont torturé au courant 120 et tous les jours, tous les jours c'était comme ça et j'étais devenu un déchet humain parce qu'à un moment donné quand il me torturait, j'avais sorti la langue, il m'ont foutuit un coup de jus sur la langue, j'avais la langue coupée. J'ai encore les traces aujourd'hui. Je me souhaitais la mort. J'ai dit pour que qu'on en finisse. Je je pouvais plus hein. Il n'était pas des viv la France loin de là. C'était des gens que les péripéties de la guerre avaient emmené à s'engager du côté de la France. Pour moi,
ce ne sont pas des tr guerre c'est terrible. Ils se sont trouvés ballottés d'un côté comme de l'autre. Les arquis qui sont parvenus à fuir vers la France sont envoyés par l'État dans des camps avec leurs familles sous surveillance militaire et dans des conditions de misère. En Algérie, l'indépendance a peine déclaré une guerre civile éclate entre des groupes opposés qui souhaitent prendre le pouvoir. Il faut attendre septembre 1962 pour qu'une République algérienne soit formée et le FLN s'impose comme parti unique. Démarre alors une longue période de reconstruction et parmi les premières mesures, le gouvernement lance
des campagnes massives d'alphabétisation à destination des populations qui n'avaient pas eu accès à l'éducation. Dans le même sens, des constructions d'écoles, de collèges et d'université sont lancées. 80 % de la population était dans la pauvreté et avec le départ massif des pieds noirs, il fallait quand même euh relever un défi, ouvrir les écoles, vacciner les gens. En France, l'intégration des Français d'Algérie appelé pied noir est compliqué. Beaucoup sont victimes de discrimination. Quand je suis arrivé dans l'école où j'ai été nommé, premier mot du directeur, vous savez que vous prenez la place un remplaçant qui était
dans cette classe. C'était déjà le bon accueil. Je n'avais rien demandé à personne mais je prenais la place de quelqu'un. Voilà comment me on m'accueillait. En Algérie, l'après-guerre est marquée par des luttes internes au FLN. Warari Bouedien alors ministre de la défense prend le pouvoir par un coup d'état en 1965 et son projet est clair : renforcer l'indépendance économique et politique du pays. Alors que l'Algérie reste encore largement dépendante de la coopération française, notamment dans l'éducation, la santé ou encore l'administration. L'Algérie se rapproche du bloc soviétique, du monde arabe et de Cuba, mais les liens
avec la France ne sont pas totalement rompus. Dans les années 60, des milliers de coopérants français travaillent en Algérie et la France maintient des bases militaires jusqu'en 1968 tout en poursuivant des essais nucléaires dans le Sahara. Malgré ces liens, donc des tensions apparaissent. En 1966, la France adopte une loi d'amnistie qui va donc couvrir les crimes commis par son armée pendant la guerre. Un choix qui heurte l'Algérie. Autre exemple, en 1971, Bouéienne nationalise les hydrocarbures, mettant fin au contrôle des entreprises françaises sur ses ressources stratégiques. Mais si cette décision marque une rupture symbolique et une
crise, elle ne met pas un terme pour autant aux échanges économiques. Les décennies suivantes sont marquées par la montée de l'islamisme politique qui culmine dans la guerre civile des années 1990 qualifié de décennies noir. Entre 60 et 150000 morts sont recensés selon les estimations. Cette guerre pousse de nombreux Algériens à chercher refuge en France, rendant la question migratoire centrale dans les relations entre la France et l'Algérie. À la fin des années 1990, Abdelazziz Bouteflica arrive au pouvoir avec la promesse d'une réconciliation nationale. Dans le même temps, la France amorce un travail mémoriel. En 1999, l'Assemblée
vote une loi qui reconnaît officiellement que la guerre d'Algérie était bien une guerre abandonnant les termes amoindrissants qui étaient utilisés jusque-l. En 2003, la visite de Jacques Chirac en Algérie est marquée par un accueil triomphal avec des foules scandants, des visas, des visas témoignant d'une réalité aussi de l'époque plus que le passé colonial. C'est souvent la circulation des personnes qui structurent le rapport de l'Algérie à la France. Sous la présidence de Nicolas Sarkozy, les relations franco-algériennes vont se refroidir, même s'il reconnaît en 2007 que la colonisation était, je cite, profondément injuste. Mais sous la présidence
de François Hollande, les relations s'améliorent. Le président Hollande développe une politique mémorielle d'apaisement sur l'Algérie. Il reconnaît les souffrances infligées à l'Algérie par la colonisation qu'il qualifie, je cite, de système profondément injuste et brutal. Il reconnaît aussi la répression, je cite, sanglante des manifestants algériens le 17 octobre 1961 à Paris ou encore, je cite les responsabilités des gouvernements français dans l'abandon des Arquis. En 2017, à leur candidat à l'élection présidentielle, Emmanuel Macron va plus loin en qualifiant la colonisation de crime contre l'humanité. Une déclaration qui suscite de fortes réactions en France. La colonisation fait partie
de l'histoire française. C'est un crime contre l'humanité. C'est une vraie barbarie. En réalité, ces dernières années, les tensions entre la France et l'Algérie ont principalement d'autres motifs que la guerre d'Algérie. En 2021, la France réduit drastiquement l'octroit de visa aux Algériens invoquant le refus de l'Algérie de reprendre ces ressortissants qui sont en situation irrégulière sur le territoire français. Plus récemment, le regain de tension, il est notamment lié à la question du Sahara occidental. En effet, la France et bien s'est alignée sur la position du Maroc. Or, l'Algérie soutient le Front Polissario qui est justement opposé
au Maroc sur la question de ce territoire. L'Algérie interprète donc les décisions françaises comme étant opposé à ses intérêts nationaux. Alors, si les sujets conflictuels sont nombreux, il serait pour autant malvenu de considérer que la colonisation et la guerre d'Algérie condamnent la France et l'Algérie à un affrontement perpétuel. Les tensions récentes sont liées à des motifs politiques et diplomatiques très actuels. Et depuis l'indépendance en 1962, il y a eu de nombreuses périodes de coopération. La France et l'Algérie restent lié par une histoire commune, des intérêts économiques et des liens humains profonds. Mais c'est aussi une
histoire lourde faite de 132 années de colonisation et 8 ans de guerre. Et je comprendrai qu'on nous dit vous rabâchez les gars, vous parlez votre Algérie mais c'est du passé hein. Mais moi je d continue à dire que il est c'est important de transmettre la mémoire euh non pas qu'on a c'est pas une leçon qu'on donne pas du tout. Je pense que si je parle ici aux jeunes, c'est pour les inciter à vraiment à lire, à chercher. Ne pas se contenter de ma parole ni de la parole de quelqu'un d'autre, mais d'avoir de faire de
de se faire sa propre opinion et surtout de savoir qu'il y a quand même un certain révisionnisme sur la guerre d'Algérie. Quand on n pas vécu des événements, il est difficile de juger de l'extérieur. Je plein les pieds noirs et surtout ceux qui ont subi des dommages terribles. Mon témoignage ne peut pas être celui d'une famille qui a connu des massacres. De la même façon, du côté algérien, chacun a une histoire bien particulière. Et Arqu il parle pas de ce qu'ils ont subi. Je suis obligé de parler de la guerre Algérie parce que pas tellement
le choix. C'est c'est resté dans ADN et je peux rien oublier ce qui s'est passé. C'est fini maintenant. Maintenant on peut regarder ensemble l'avenir. Les Français que tu côtoies aujourd'hui ne sont pour rien dans la torture qui a été infligée à ton père ou votre grand-père. Par contre, il faut qu'il reconnaisse ce qui s'est passé. Merci à Sylvie Teno, directrice de recherche au CNRS et spécialiste de cette période de nous avoir accompagné sur la rédaction de cette vidéo. Merci également à tous les témoins qui ont accepté de répondre à nos questions et de partager leurs
archives personnelles. Évidemment, pour nous soutenir et découvrir nos prochaines vidéos, vous pouvez vous abonner. Merci pour votre confiance. On se dit à très vite. [Musique]
Related Videos

1:21:11
L’histoire stupéfiante du « pacte de corru...
HugoDécrypte - Grands formats
1,847,750 views

1:13:38
Elle a grandi avec un terroriste chez elle...
HugoDécrypte - Grands formats
584,255 views

1:00:11
La véritable histoire de la conquête franç...
Mediapart
643,489 views
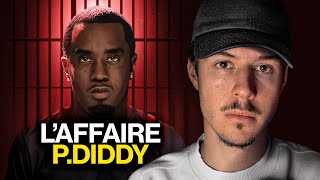
1:14:47
THE P. DIDDY CASE: a summary
SEB
3,784,980 views

49:40
Si vous pensez mal manger, regardez cette ...
HugoDécrypte - Grands formats
1,943,732 views

33:14
Niger - Orano: The Final Battle? The End o...
Alain Foka Officiel
131,801 views

50:03
Algérie : le plus GRAND pays d'Afrique | W...
SLICE Voyage
2,394,252 views

2:32:41
Algeria: The Black Decade and the Weight o...
Notre Histoire
417,869 views

1:40:14
Trois mille milliards : les secrets d'un É...
Contribuables Associés
3,419,504 views

54:55
QUI EST L'IMPOSTEUR ? (ft Tiakola & SDM)
SQUEEZIE
9,431,152 views

56:16
DJ Snake me dévoile l'envers du décor (tou...
HugoDécrypte - Grands formats
292,869 views

58:55
Elle a défendu le terr0riste Salah Abdesla...
HugoDécrypte - Grands formats
1,604,480 views

53:04
Narendra Modi : Modi : le leader controver...
SLICE Qui ?
101,523 views

1:05:50
Vincent Bolloré et son empire : enquête su...
Mediapart
511,158 views

1:47:29
Jacques Chirac, l'homme qui ne voulait pas...
Documentaire Société
22,879 views

37:02
La véritable histoire du féminisme
Gaspard G
306,516 views

53:06
Catholique, juif, musulman : quand trois r...
Brut
1,494,543 views

44:17
L'Histoire Obscure de la Médecine sur 45 0...
Poisson Fécond
470,929 views

2:28:02
L'HISTOIRE DE STAR WARS (George Lucas, Luc...
Sofyan
558,772 views

1:41:20
L'HISTOIRE FOLLE DES BEATLES !
SEB
2,062,741 views